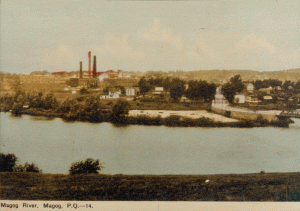Natif d’un « petit village » des Cantons-de-l’Est, M. Arthur W. Ling (1889-1966) fit carrière toute sa vie durant, dans le domaine bancaire. Après des séjours d’initiation (en 1907) à la Banque Molson de Victoriaville, puis à celle du Canal Lachine, il fut transféré à la succursale de Chicoutimi de cette banque en 1908, puis à Sainte-Thérèse en 1912. Peu après son mariage en 1915, il entre à l’emploi de la Banque Molson de Waterloo à titre de teneur de livres : dispensé par la banque de s’enrôler dans l’Armée, c’est à cette époque qu’il commence à s’intéresser (selon ses propres termes) plus « sérieusement » à sa carrière de banquier, poursuivant des études en Affaires bancaires avec l’Université Queen’s de Kingston, puis en Économie et Finances avec l’Institut Alexander Hamilton de New York; quelques années plus tard, il se voyait accorder un prix d’excellence de l’Association bancaire canadienne (Canadian Bankers’ Association). Au terme de quatre années à Waterloo, il se vit nommer gérant de la Banque à Saint-Ours-sur-Richelieu, puis à Trois-Pistoles en 1923. Peu après (1925), la Banque Molson fut incorporée à la Banque de Montréal, et Arthur W. Ling poursuivit à titre de gérant pour la nouvelle banque à Trois-Pistoles durant trois années supplémentaires.
 C’est alors, vers 1928, qu’Arthur Ling fut muté à Magog, en tant que gérant de la Banque de Montréal locale, qui y opérait à perte depuis 14 ans : M. Ling releva le défi de mieux positionner la Banque dans le marché magogois, en optant pour une stratégie de « good will », qui l’amena à s’impliquer à fond dans le développement de la communauté. C’est à ce titre qu’il contribua à fonder la Chambre de Commerce de Magog, dont il fut longtemps l’un des dirigeants; il mit également sur pied une agence de développement industriel, puis un bureau de tourisme, tout en s’impliquant dans divers clubs sociaux. Lors du Centenaire de la Paroisse Saint-Patrice, en 1936, il publia en collaboration avec sa fille Patricia, une histoire de cette paroisse et de la ville depuis ses origines.
C’est alors, vers 1928, qu’Arthur Ling fut muté à Magog, en tant que gérant de la Banque de Montréal locale, qui y opérait à perte depuis 14 ans : M. Ling releva le défi de mieux positionner la Banque dans le marché magogois, en optant pour une stratégie de « good will », qui l’amena à s’impliquer à fond dans le développement de la communauté. C’est à ce titre qu’il contribua à fonder la Chambre de Commerce de Magog, dont il fut longtemps l’un des dirigeants; il mit également sur pied une agence de développement industriel, puis un bureau de tourisme, tout en s’impliquant dans divers clubs sociaux. Lors du Centenaire de la Paroisse Saint-Patrice, en 1936, il publia en collaboration avec sa fille Patricia, une histoire de cette paroisse et de la ville depuis ses origines.

Durant les années 1930, Arthur Ling allait également avoir un impact décisif sur l’avènement du Parc Provincial du Mont Orford, en amenant les chambres de commerce et les dignitaires de toute la région à soutenir les efforts du Dr. George Bowen pour la création du parc. IL fut par la suite l’un des principaux instigateurs du Club de Golf du Mont Orford, puis du Club de Ski du Mont Orford, dont il fut le premier président. C’est ainsi, durant son séjour de 14 années à Magog, que M. Arthur Ling apporta une contribution décisive au développement de la Ville et de la région tout entière. En 1941, la Banque de Montréal devait le transférer, avec toute sa famille – plutôt réfractaire à quitter Magog –, pour diriger une importante succursale de la banque à Montréal, au coin des rues Saint-Laurent et Laurier. Il parvint aussi à rentabiliser cette succursale, en triplant son personnel et ses profits, avant de prendre sa retraite en 1951, après quoi il oeuvra comme administrateur pour les cités d’Outremont et de Mont-Royal. Grand amateur de golf et de sculpture sur bois, Arthur W. Ling laissa une empreinte profonde sur plusieurs villes et organisations, en particulier à Magog. Il décéda en novembre 1966, quelque peu déçu de n’avoir pas pu survivre jusqu’à l’ouverture prochaine du Métro de Montréal.
Le Fonds Arthur W. Ling qui fut offert à la SHM par M. Michel Tanguay, comprend plusieurs brochures d’époque (dont sa propre monographie sur la « Paroisse Saint-Patrice – Magog 1886-1936 – Souvenirs historiques » et quelques autres, des items concernant le « Mount Orford Golf and Country Club », ainsi qu’une copie d’un document autobiographique adressé au siège social de la Banque de Montréal : il y relate les grandes étapes de sa carrière bancaire et communautaire. Pour compléter le tout, le fonds Ling comprend une quarantaine de photographies et de cartes postales d’époque – dont 16 photographies de qualité exceptionnelle (noir et blanc, grand format) réalisées par George A. W. Abbott. Curieusement, une seule de ces photos de George Abbott vient dupliquer une photographie que nous avions déjà dans le fonds personnel du photographe.
Pierre Rastoul, Société d’histoire de Magog